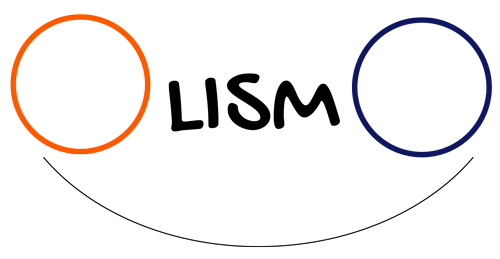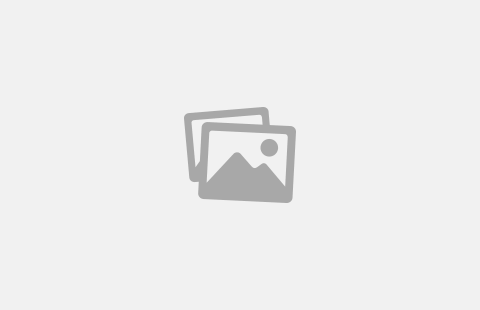Suite à notre dernier article sur la psychologie du couple, il m’a semblé opportun d’approfondir ce mois consacré à la thématique de la relation à l’autre sous l’angle opposé. On s’intéressera donc à la solitude. D’après la Fondation de France, l’isolement relationnel touche aujourd’hui 24% des français, soit 16 millions de personnes. L’isolement se lie souvent à la précarité et à l’âge bien que les jeunes soient de plus en plus concernés. Mais peut-on vraiment vivre sans les autres ?
Les citations sur la relation sont nombreuses, notamment parfois pour mettre en garde contre l’autre. On dit par exemple qu’il « vaut mieux être seul que mal accompagné », mais est-ce réellement le cas ? Peut-on se permettre actuellement, dans nos sociétés, de se retrouver seul et de ne pas en souffrir ?
C’est quoi être seul ?
Plusieurs façons de voir la solitude et l’isolement
Difficile de décrire la solitude aujourd’hui, tant celles-ci peut prendre plusieurs formes. Certains disent parfois être « seul », pour décrire l’absence de relation de couple. Là ou d’autres utilisent le même mot pour décrire une situation d’isolement profond et une absence totale de relation avec les autres. Parfois même, certaines personnes valorisent la solitude comme un choix, un besoin et un idéal de vie. Ceux-ci mettent l’accent sur l’idée de se suffire à soi-même et de trouver bonheur et satisfaction en se retrouvant seul avec son indépendance et ses pensées.
Il arrive ainsi que la solitude soit valorisé à travers l’idée de vivre de façon indépendante. Cela en mettant en avant l’autonomie à travers l’adoption d’un rythme et d’habitudes de vie qui ne dépendent pas d’un entourage proche.
La solitude ne semble donc pas uniquement liée au fait de vivre seul ou non. Elle paraît liée davantage à l’impression de porter, supporter seul et sans l’aide des autres, les difficultés liées à tous les obstacles auxquels nous nous confrontons immanquablement dans la vie quotidienne.
Pourtant, se sentir « seul et isolé », c’est également se définir par rapport aux autres et à un groupe social duquel on serait exclu. Ce que beaucoup vivent au quotidien par contrainte et de façon subie.
Ainsi, j’ai par exemple pu rencontrer en consultation une personne souffrant d’un isolement profond. Les rapports conflictuels avec sa famille et ses proches, l’avait contraint à déménager dans une région où elle ne connaissait personne dans l’espoir de recommencer une nouvelle vie. Ses relations avec les autres sont durablement devenues quasi-inexistantes, à l’exception de quelques rapports humains notamment avec la voisine de palier lorsqu’elles se croisaient dans l’ascenseur et se disaient poliment bonjour. Sans le savoir, cette voisine était alors investie comme sa relation « amicale » la plus proche.
Cette forme de solitude et d’isolement, non réellement choisie, est alors particulièrement pénible pour la personne concernée. Elle constitue une souffrance morale et psychique profonde.
La relation à l’autre, un besoin fondamental ?
La pyramide des besoins de Maslow a été conçue dans les années 1940 pour représenter schématiquement les fondamentaux de tout être humain afin de se sentir accompli. Elle prend cette forme pour hiérarchiser les besoins en fonction de leur priorité, ceux étant à la base devant être satisfaits avant tout. On y retrouve ainsi par ordre d’importance :
- Les besoins physiologiques primaires (sommeil, alimentation, sexualité, habillage, etc.), qui peuvent plus ou moins varier pour chaque individu.
- Les besoins de sécurité, qui se concentrent sur la protection physique et morale nécessaires (stabilité de logement, physique, financière, matérielle, morale, familiale, de santé, etc.).
- Les besoins d’appartenance qui dépendent essentiellement de la relation à l’autre (affectif, amitiés, relation de couple, acceptation et/ou adhésion au sein d’un groupe social, etc.).
- Les besoins d’estime, soit la façon dont on se sent reconnu, réputé et estimé par l’autre, qui permet confiance et estime de soi.
- Les besoins d’auto-accomplissement, permettant de mettre en avant ses compétences et son potentiel dans la réalisation de ses objectifs et de son ambition personnelle.
On reconnait que chaque individu puisse prêter plus ou moins d’importance à la satisfaction de chacun de ces besoins. Mais il paraît difficile d’envisager l’accomplissement de soi dans cette théorie de la motivation sans s’inscrire dans une forme de relation à l’autre. En effet, même lorsqu’on aborde la question du besoin physiologique, base de la pyramide des besoins de Maslow, l’autre y prend déjà une place relative.
La solitude, quel problème ?
Solitude et isolement
Pourquoi alors certains semblent valoriser une certaine forme de retrait dans les relations sociales? Là où d’autres expriment la souffrance d’une solitude pesante et éprouvante ?
L’intensité de l’isolement est évidemment à prendre en compte. Lors de mes recherches pour la rédaction de cet article, j’ai lu de nombreuses chroniques prônant une vie solitaire. Elles mettent en avant certains avantages relevant d’une autonomie et d’un désir d’indépendance (pouvoir faire ses propres choix de vie, ne pas « subir » de consignes morales, etc.).
Mais cette forme solitude n’est pas réellement comparable à l’isolement que de plus en plus de plus de personnes vivent au quotidien. Ces personnes n’ont pas la possibilité de sortir entre amis, de voir leur famille, ou encore d’avoir accès à un emploi et d’échanger quotidiennement avec des collègues. L’isolement renvoie ainsi à une forte limitation, voire une absence de contact avec l’autre. Les motifs peuvent prendre plusieurs formes. On peut par exemple penser aux personnes souffrant d’anxiété sociale, pour qui l’autre peut être perçu comme menaçant et insécurisant. Ou encore aux personnes ayant subi des expériences d’échecs ou d’humiliation répétées, mettant en place des conduites d’évitement comme mécanismes de défense usuels afin de se protéger de ce qui pourrait advenir. D’autres encore évitent de créer des liens par peur de l’attachement et de la souffrance qu’ils pourraient éprouver en anticipant la perte de l’autre.
Cet isolement subi induit une perte d’identité et d’égalité, un repli sur soi qui tend à rendre la capacité à nouer à nouveau des liens de plus en plus difficile.
L’enfer, c’est les autres ?
Comment vivre avec ce vide et ce manque de l’autre ? Peut-on éviter cet isolement ? Comment voir l’autre autrement, parfois dépasser ce qu’on a pu vivre et (re)prendre du plaisir dans la relation ?
Pour retrouver une certaine sociabilité et parvenir se décentrer de soi-même et de ce qu’on vit au quotidien, la perception de l’autre comme une ressource est une notion qui paraît importante. L’autre peut être un soutien moral, affectif, ainsi qu’une présence face aux difficultés de vie qui surviennent de façon imprévue.
Evidemment, tout dépend du caractère et de la personnalité de chacun. Pour certains, le repli peut prendre la forme d’un besoin d’être seul avec soi-même, de marquer son indépendance ou encore pour se (re)construire.
Il est également intéressant de réfléchir à ce qui peut faire obstacle à notre communication et nos relations à l’autre, qui ne doivent pas nécessairement s’instituer dans un rapport de soumission ou d’opposition. Mais aussi d’être soi-même une présence et une écoute pour l’autre, ce qui nécessite d’être en capacité de s’adapter.
La relation impose également de savoir demander, donner, recevoir, refuser. Tout cela dans le respect de soi et de l’autre. Nous devrions tous être en capacité de mieux nous affirmer, sans nécessairement chercher l’approbation de l’autre. Pouvoir nous positionner clairement sans imposer nos idées.
Cependant, la notion d’isolement recoupe de nombreux concepts qu’il paraît difficile de tout aborder dans un seul article. Si la solitude peut paraître choisie ou subie, certaines personnes, très isolées peuvent se sentir bien et ne pas en souffrir. D’autres l’exprime malgré un entourage proche. Et d’autres encore ont ce besoin de se mettre en retrait « à petites doses » de la relation. Cela afin de pouvoir être à l’écoute de soi, de ses émotions, de ses besoins, de ses difficultés.
Savoir si on peut vivre seul interroge en permanence notre capacité à être seul, notre besoin d’indépendance et de réussir à trouver cet équilibre entre les temps pour soi et les autres.
Et vous ? Pouvez-vous vivre sans les autres ?
Pour aller plus loin (sources) :
Salomé, J. (2002). Vivre avec les autres. J’ai lu.
Arènes, J. (2007). Apprendre à être seul en présence de l’autre. Imaginaire & Inconscient, 20, 123-135.
Graziani, P., & Pedinielli, J. L. (2003). Anxiété et troubles anxieux. Nathan.