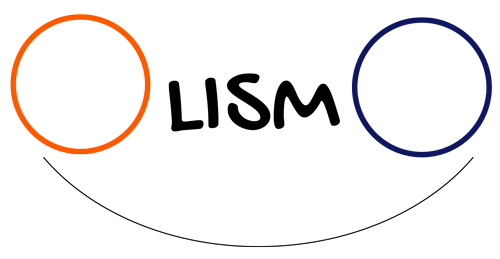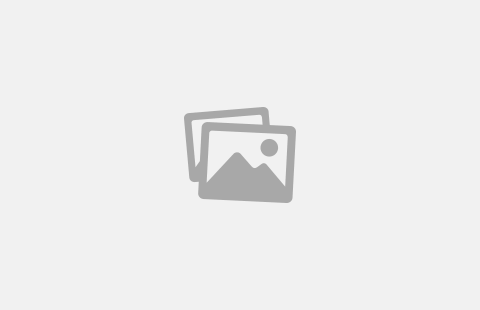Notre article consacré au stress au travail avait permis d’aborder brièvement les différents troubles anxieux. Si cela semble difficile de définir précisément chacune de ces formes, nous verrons à quoi elles correspondent et leurs manifestations.
Au cours de leur vie, 15 à 20% de la population est amenée à être affectée par un trouble anxieux. Sensation pénible de danger et de malaise profond, cette anxiété peut être soudaine ou progressive. Elle peut même durer plusieurs jours avec une intensité variable. Nous verrons ici comment ces troubles peuvent affecter les personnes concernées. Cela avant de s’intéresser, dans un second article, aux moyens de prévention.
Formes d’anxiété ?
Peur ou anxiété :
Commençons tout d’abord par distinguer l’anxiété de la peur, les deux étant généralement confondus. En effet, ces deux états partagent des points communs (comme l’éveil physiologique intense, l’affect négatif, un sentiment de nervosité et de tension accompagnés de sensations corporelles). Aussi, la peur-phobie fait partie des troubles anxieux. Néanmoins, on peut mettre en évidence certaines différences entre ces deux états :
| Peur | Anxiété |
| Danger spécifique et identifié | Source de danger floue, parfois sans objet |
| Lien établi entre la source et le ressenti | Lien incertain |
| Manifestation épisodique | Manifestation prolongée |
| Tension circonscrite | Tension envahissante |
| Imminence de la menace | Menace incertaine, rarement immédiate |
| Sentiment d’urgence | Vigilance intense |
Pour être plus précis, la peur fait référence à un objet bien spécifique et les symptômes se manifesteront uniquement face à lui. Dans le cas d’une phobie fréquente, par exemple l’arachnophobie, la sensation de peur et les réactions intenses surviendront lors de la présence de l’araignée, ou dans le cas de forme plus sévère, suite à l’imagination ou la vision d’une image qui la représente.
A contrario, le ressenti d’anxiété a une origine incertaine. Elle peut se déclencher à la suite d’une représentation inconsciente face à une situation donnée, face à laquelle la personne se sent impuissante. Et cela peut se manifester sur des temps qui paraissent pourtant anodins, sans lien apparent avec l’état de débordement provoqué. Les manifestations neurovégétatives (comparables à celles de chocs émotionnels) peuvent être diverses, comme des appréhensions, un sentiment d’effroi, des vertiges, des tremblements, des malaises, etc.
Psychopathologie des troubles anxieux
On repère généralement 6 grands groupes de troubles anxieux :
- Le trouble anxieux généralisé
Il s’agit d’un fond d’anxiété accompagné de soucis excessifs durable et incontrôlable, associé à des symptômes d’agitation, d’hypervigilance, de fatigabilité, d’irritabilité ainsi que de troubles de la concentration, de la mémoire et du sommeil.
Les manifestations de ces appréhensions restent globalement disproportionnées par rapport à la réalité des risques, bien que cela puisse s’étayer sur des problématiques essentielles de la vie quotidienne (santé, finances, logement, emploi, etc.).
- Le trouble panique
Cet état se traduit par un état anxieux particulièrement intense causant des symptômes physiques (palpitations, transpiration, sensation d’étouffement, nausées, frissons, vertiges, etc.) et psychiques (déréalisation, dépersonnalisation, perte de contrôle, crainte de la mort, etc.).
On peut par exemple penser à l’agoraphobie. Elle correspond à cette angoisse que certaines personnes éprouvent au sein de lieux publics ou à l’extérieur.
Dans le cas de trouble ou d’attaque de panique, on peut également mentionner un effet pervers qui se caractérise par la peur de la survenue d’une nouvelle crise. La personne qui a vécu une ou plusieurs crises d’angoisse, parfois fréquente et imprévisible, vivra alors dans la crainte par anticipation d’une nouvelle attaque. Elle tentera alors d’éviter cet environnement perçu comme menaçant pour se préserver. L’anxiété s’auto-alimente alors.
- Le trouble d’anxiété sociale (ou phobie sociale)
L’anxiété est ici liée aux situations d’interactions sociales et au regard de l’autre ou d’un groupe. Les manifestations physiques sont globalement similaires à celles du trouble panique. Mais peuvent s’accompagner de rougissement, d’envies pressantes d’uriner, de douleurs musculosquelettiques, de migraines ou de bégaiements.
L’estime de soi en est profondément impactée. Les personnes concernées peuvent avoir tendance à se mettre en retrait de la vie sociale par peur d’être jugées, de perdre leurs moyens en public, de mal faire voire de l’apparition de certains symptômes.
Prenons l’exemple de l’éreutophobie (la peur obsédante de rougir en public). Lors d’une prise de parole en public ou après un ressenti émotionnel, les personnes touchées vont avoir tendance à rougir, éprouver des sensations de chaleur, penser que les autres se focalisent dessus, notamment lorsqu’ils y font référence. Par crainte de s’exposer au regard d’autrui et par anticipation de la survenue de rougeur, ces personnes peuvent alors s’installer dans un isolement, un retrait social et un repli sur soi.
- La phobie spécifique
Elle se manifeste par la crainte angoissante, excessive et irraisonnée face à un objet manifeste (orage, ascenseurs, sang, etc.), un animal (araignée, serpent, etc.) ou une situation particulière (hauteur, espaces clos, etc.).
Ces manifestations s’estompent généralement lorsque le stimulus n’est plus présent. Selon la phobie, il peut s’agir d’un trouble plus ou moins handicapant.
À noter que certaines phobies semblent « héréditaires ». Lors d’une étude publiée dans « Frontiers in Psychology » de l’institut Max Planck, en 2017 (lien en bibliographie), les chercheurs ont présenté à des nourrissons de 6 mois des images d’araignées et de serpents et ont observé une activation du système noradrénergique, neuromédiateur principalement lié aux réactions de stress, là où les réponses émotionnelles étaient différentes s’agissant d’autres animaux.
- Le trouble obsessionnel compulsif (TOC)
On distingue ici deux types de symptômes principaux qui sont l’obsession et la compulsion, qui peuvent tous deux avoir de profonds retentissements sur la vie quotidienne.
L’obsession est une pensée, idée ou représentation anxiogène envahissante et répétée qui s’impose à la conscience sur des thèmes spécifiques (propreté, sexualité, ordre, religion, etc.).
Tandis que la compulsion va être une réflexion (prière, prononciation d’une suite de mots, énumération de chiffres) ou une action (se laver les mains, précaution, vérification, rangement, etc.) par laquelle la personne devra impérativement passer pour chasser l’obsession et s’en défendre.
- L’état de stress post-traumatique
Enfin, ce dernier trouble survient lorsque le sujet a été exposé à un événement traumatique lors duquel lui ou d’autres ont pu être confrontés au risque de mort ou de grave blessure, se traduisant par une peur intense et un sentiment d’impuissance et d’effroi.
Certaines manifestations vont alors apparaître à travers :
- Des reviviscences, lors desquelles la personne revit à travers l’irruption dans la pensée de souvenirs, de rêves ou d’hallucinations liés à l’événement traumatique, et à l’origine d’une réactivation des symptômes ressentis au moment où celui-ci s’est produit.
- Un évitement de tous les stimuli liés à l’événement (pensée, conversations, activités, lieux, personnes présentes, etc.) conduisant à un retrait social et un émoussement affectif.
- Des symptômes neurovégétatifs, comme des troubles du sommeil et de la concentration, une hypervigilance, des accès de colère…
- Une souffrance altérant la vie quotidienne liée à l’impact social, professionnel et émotionnel.
Pour aller plus loin (sources) :
André, C. (2005). Psychologie de la peur : Craintes, angoisses et phobies. Jacob.
Graziani, P., & Pedinielli, J. L. (2003). Anxiété et troubles anxieux. Nathan.
https://tcc.apprendre-la-psychologie.fr/troubles-anxieux.html