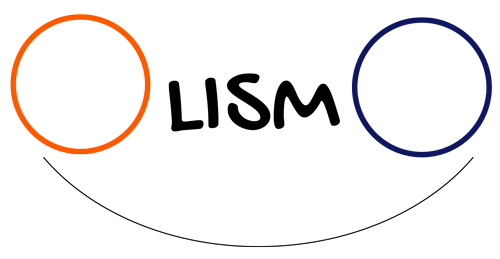Les sens — ou perceptions sensorielles — sont essentiels dans notre vie quotidienne. En effet, la qualité de nos échanges non verbaux est possible grâce au développement de la perception. Lorsqu’il y a une stimulation extérieure ou intérieure des récepteurs sensoriels, l’information sensorielle est transmise au cortex par voie nerveuse où elle est analysée, identifiée et reconnue : l’information est ainsi perçue. L’intégration (le traitement) des stimulations sensorielles fait partie intégrante d’une organisation fondamentale dans le développement de l’humain. Au fur et à mesure des expériences sensorielles, l’être humain établit des liens entre ses expériences sensorielles, motrices, relationnelles et affectives. Les perceptions sensorielles s’organisent alors. In fine elles prennent sens permettant ainsi d’avoir une représentation cohérente du monde extérieur et de soi également. Cependant, certaines personnes présentent des troubles de la modulation sensorielle. On parle alors d’hypersensibilité ou d’hyposensibilité sensorielle.
Il s’agit de particularités au niveau de l’intégration de l’information sensorielle impliquant qu’une personne peut, par exemple, présenter un seuil d’intégration particulièrement bas. Cette personne présente alors une hyperréactivité ou hypersensibilité, car elle détecte les stimuli sensoriels même lorsqu’ils paraissent légers. Une autre personne peut présenter un seuil d’intégration particulièrement élevé. Auquel cas on parlera plutôt d’hyporéactivité ou hyposensibilité, car les stimuli doivent être intense pour entrainer une réaction sa part. Ici, nous développerons l’hypersensibilité sensorielle.
L’hypersensibilité sensorielle
L’hypersensibilité est caractérisée par une réaction dite extrême aux stimulations internes ou externes. Si le terme « hypersensibilité » est le plus souvent utilisé comme synonyme d’hyperémotivité (réaction émotionnelle extrême aux évènements), l’hypersensibilité peut être également sensorielle. Elle concerne alors des réactions en lien avec les différentes stimulations captées par nos sens.
Quand une personne présente une hypersensibilité sensorielle, l’énergie dépensée pour gérer les effets physiques et émotionnels qui font suite à la perception des stimulations sensorielles est relativement intense. Ces stimulations peuvent ainsi mettre en difficultés les personnes concernées dans leur quotidien. D’autant plus que les sensations désagréables peuvent durer plusieurs minutes voire plusieurs heures.
Plus que 5 sens
Depuis jeunes, nous apprenons que le corps est pourvu de 5 sens : la vue, l’ouïe, l’odorat, le toucher et le goût. Bien heureusement, le corps étant relativement complexe, le système sensoriel l’est tout autant ! Cela afin de permettre de nous adapter de la façon la plus optimale aux évènements extérieurs, mais également aux manifestations internes !
C’est ainsi que sont répertoriées une vingtaine de modalités sensorielles. Dans cet article, je présente une liste non exhaustive des principales modalités sensorielles et des réactions d’hypersensibilité associées. Je détaillerai leur origine dans un prochain article.
La vision
La vision saisit les informations lumineuses (les photons) grâce aux bâtonnets et aux cônes (récepteurs) de la rétine. Ils permettent ainsi à l’œil de prendre en compte les différents éléments de l’environnement, leur forme, leur couleur, les déplacements des éléments et l’intensité lumineuse.
Une hypersensibilité visuelle peut entrainer un inconfort vis-à-vis de la lumière naturelle du soleil, des lumières artificielles, des lumières fluorescentes, des lumières de flammes (bougies, brasier…) lorsqu’il s’agit de photophobie. L’hypersensibilité visuelle peut impliquer également un inconfort à la vue de certaines textures. Mais aussi d’un environnement peu épuré tout comme dans une foule de personnes. La personne ressentira alors des gênes visuelles (larmes, brûlure, sécheresse) voire des gonflements et rougeurs, une sensation de fatigue, une irritabilité, des maux de tête ou migraine, des nausées, des vomissements, des raideurs corporelles, des sensations d’étourdissement ou de picotement dans l’ensemble du corps.
L’audition
L’audition perçoit les vibrations sonores informant sur l’intensité du son et les variations de rythmes sonores (de l’aigüe au grave) à l’aide des cellules ciliées situées dans l’oreille interne.
L’hypersensibilité auditive entraine des inconforts en présence de sons forts. Des sons que l’on peut retrouver dans les basses, les festivals ou encore lors des feux d’artifice. L’agression peut provenir également du brouhaha provoqué par la foule, les trafics automobiles, les centres commerciaux. Des bruits répétitifs, en particulier s’ils sont irréguliers, peuvent impacter les capacités d’attention et générer du stress. Les différents timbres de voix peuvent être source d’inconfort.
L’olfaction
L’olfaction reçoit les informations des molécules odorantes grâce aux cils olfactifs de la tâche olfactive (zone sensible du nez).
Une hypersensibilité olfactive entraine des réactions viscérales provoquant alors des haut-le-cœur accompagnés de nausées et de possibles malaises, qu’il s’agisse d’odeur malodorante ou de parfum. Cette hypersensibilité est en relation étroite avec l’hypersensibilité gustative, pour cela elle peut induire ou accentuer des intolérances ou des rejets de certains aliments.
Le goût
Le goût (ou gustation) capte les informations gustatives grâce aux papilles gustatives situées au niveau de la langue et du palais.
Les personnes présentant une hypersensibilité gustative ressentent un dégoût pour un grand nombre d’aliments, entrainant généralement des nausées et vomissements. Les aliments liquides sont généralement mieux tolérés, car le temps de mastication est réduit permettant alors un passage plus rapide en bouche.
Le toucher
Le toucher discerne la déformation de la peau grâce aux mécanorécepteurs (neurones sensibles aux sollicitations mécaniques de la peau). Le sens du toucher entraine la reconnaissance des objets et leur position par le contact physique. Néanmoins, la sensibilité tactile peut être associée également à la pallesthesie (le sens vibratoire) et au sens de la pression. Leur distinction est subtile, car il s’agit de différents niveaux de l’épiderme à l’os.
Les personnes présentant une hypersensibilité tactile sont réticentes au contact physique qu’ils s’agissent d’autrui ou d’objet. Elle peuvent être sensibles aux différents textiles ou encore montrer une préoccupation particulière pour les gestes d’hygiène.
La thermoception et la nociception
La nociception cible les stimuli douloureux grâce aux nocicepteurs (les récepteurs de la douleur). La thermoception quant à elle, capte les informations thermiques variant du chaud au froid.
Ces hypersensibilités se manifestent par des réactions émotionnelles fortes à la douleur et aux changements de température, mais également par une difficulté à choisir un vêtement adéquat pour sortir selon la météo.
Le sens de l’équilibre (le vestibulaire)
Le sens vestibulaire est le sens de l’équilibre qui détermine la capacité à lutter contre la pesanteur, ainsi éviter les chutes et maitriser les changements de niveau, cela grâce aux cellules ciliées de l’oreille interne, ses canaux semi-circulaires et ses organes otolithiques. C’est ainsi que la vision se stabilise lors des mouvements de la tête et que la posture se maintient également lors des déplacements du corps (en particulier lors des sauts, des glissades, des déplacements en ascenseur ou en voiture).
Les personnes présentant une hypersensibilité vestibulaire appréhendent des situations mettant à l’épreuve leur équilibre telles que des sols présentant du relief, les personnes ont alors tendance à favoriser de façon prononcée l’immobilité. Les attractions à sensation, les mouvements d’ascenseur et les déplacements dans les transports sont également des situations pouvant être mal vécues.
La proprioception
Cette proprioception définit notre capacité inconsciente à percevoir la position des parties de notre corps dans l’espace sans dépendre du sens de la vision. La proprioception englobe la kinesthésie (le sens des mouvements des parties du corps), la statesthésie (le sens postural), et le sens tendineux ligamentaire (appelé aussi la « force musculaire »).
Les hypersensibilités proprioceptives provoquent généralement moins d’inconfort que les hyposensibilités proprioceptives, ces dernières entrainant généralement maladresse, postures atypiques et difficulté à jauger sa propre force. Une personne présentant une hypersensibilité proprioceptive aura tendance à montrer des difficultés à adopter une posture stable, car elle ressentira une gêne permanente à la moindre modification de son installation — telle la princesse au petit poids.
La somesthésie
La somesthésie concerne la perception consciente des modifications se jouant au niveau des muqueuses, de viscères, du système musculaire et ostéoarticulaire.
Il s’agit ainsi de la capacité du corps à saisir les informations internes lui permettant de maintenir une homéostasie.
Les personnes avec une hypersensibilité somesthésiques montrent des difficultés à résister à leur sensation de faim ou leur envie d’uriner. Cela a également un impacte sur les capacités d’attention, car cette dernière peut être perturbée par les modifications permanentes du corps que ces personnes ne parviennent pas à ignorer.
L’hypersensibilité sensorielle : un défi quotidien pour le corps et l’esprit
Vivre avec une hypersensibilité sensorielle, c’est composer avec un flot incessant de stimulations qui peuvent rapidement devenir écrasantes. Chaque son, chaque lumière, chaque texture ou odeur peut être perçu avec une intensité décuplée. Cela provoque un inconfort physique marqué : fatigue chronique, migraines, tensions musculaires, voire des réactions de stress aigu.
Sur le plan mental, cette hyperréactivité engendre une vigilance constante, une difficulté à filtrer les informations et un épuisement psychique qui peut mener à l’anxiété, voire à des troubles du sommeil.
Socialement, l’hypersensibilité sensorielle isole. Le bruit des conversations dans un restaurant, l’éclairage agressif d’un supermarché, ou encore le contact physique imprévu dans une foule peuvent être vécus comme de véritables épreuves.
Cette surcharge sensorielle rend les interactions complexes, obligeant parfois à éviter certains lieux ou à mettre en place des stratégies d’adaptation épuisantes. Je vis moi-même avec une synesthésie — une particularité sensorielle où les perceptions se mélangent. Naturellement, je comprends à quel point notre rapport aux sensations peut influencer notre quotidien de manière profonde et parfois invalidante.
Vers une meilleure compréhension des sensibilités atypiques
Pour conclure, l’hypersensibilité sensorielle met en lumière la complexité et la diversité de nos perceptions du monde. Nos sens sont essentiels à notre développement et à nos interactions. Néanmoins, ils peuvent aussi devenir une source de fatigue et de souffrance lorsqu’ils sont exacerbés. Adapter son environnement, sensibiliser son entourage et apprendre à identifier ses propres limites sont autant de pistes pour mieux vivre avec cette particularité. Mais cela suffit-il réellement à compenser la surcharge sensorielle du quotidien ? Comment favoriser une meilleure prise en compte de ces particularités dans nos sociétés ultra-stimulantes ? Peut-on imaginer des environnements plus inclusifs pour les personnes hypersensibles ? Autant de questions qui méritent réflexion pour bâtir un monde plus adapté à la diversité sensorielle de chacun.
Pour aller plus loin (sources)
B. Godderi, O. Quentin. » Snoezelen un monde de sens » 2016, Petrarque Edition
A. D’Ignazio, O. Gorgy. » Concevoir des programmes sensoriels pour personnes autistes » 2022, Editeur : Tom Pousse
Ideereka. « Tout savoir sur la surcharge sensorielle dans les TND ! » Sur le site https://www.ideereka.com/article/surcharge-sensorielle-dans-les-tnd
L. Leblanc. » Appréhension de la synesthésie dans l’interaction verbale chez des enfants autistes », 2018 Thèse, Université de Lorraine. Sur le site https://hal.univ-lorraine.fr/hal-01833220/document
E. Hubbard, V. Ramachandran. » La synesthésie ou la confusion des sens « , 2006. CERVEAU 1 PSYCHO N°14. Sur le site https://www.cerveauetpsycho.fr/sd/perception/la-synesthesie-ou-la-confusion-des-sens-1451.php
Caspar, Émilie A. et al. « Revue d’un phénomène étrange : la synesthésie ». L’Année psychologique, 2013/4 Vol. 113, 2013. p.629-666. Sur le site shs.cairn.info/revue-l-annee-psychologique1-2013-4-page-629?lang=fr