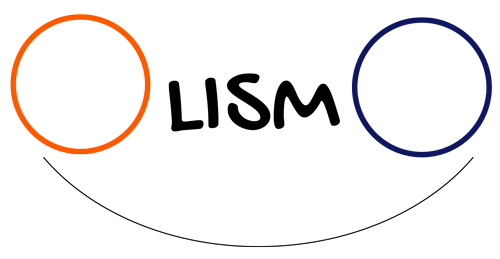Bien que l’engouement pour les rencontres virtuelles fait de moins en moins polémique dans notre société, certains prônent encore la supériorité de la qualité des rencontres dans la « vraie vie ». La spontanéité et la magie de la rencontre réelle seraient-elles menacées ? Nous avons développé les processus sensoriels mis en jeu lors d’une rencontre amoureuse virtuelle dans la première partie de cette thématique. Mais de nombreux enjeux psychocorporels prennent place dans ce type de rencontre, la rendant ainsi presque aussi réelle — par opposition au virtuel — que nature. Les messages différés peuvent donner l’impression d’une proximité troublante quand notre interlocuteur se permet une remarque accentuée ou une familiarité certaine. Aussi, nous pouvons frapper les touches d’un clavier avec une excitation corporelle remarquable pour échanger avec ce partenaire. Les divers émojis, permettant d’imager nos émotions, sont des vecteurs de sensations fortes.
Nous reprenons la situation fictive de Sophie, inscrite sur un forum de cuisine nommé Zeste de Citron, entamant une relation virtuelle avec Stranger36. On maintien le postulat qu’il s’agit d’une situation d’une rencontre virtuelle amoureuse entamée sur une base de bienveillance. C’est-à-dire avec deux protagonistes qui sont de bonne volonté et donnent des indications véridiques sur leur identité. Et cela, avec une réelle motivation pour le rapport à l’autre et ne présentant aucune pathologie psychique notable.
S’ATTACHER À l’AUTRE PAR LES MOTS
Nous avions vu que lors d’une rencontre amoureuse virtuelle, les personnes s’appuient sur ce que j’ai nommé un « puzzle de sensation ». Elles associent les informations sensorielles permettant de percevoir l’autre, collectées de façon isolée en termes d’espace et de temps. Cela pour développer une représentation imaginaire du partenaire en prévision de la rencontre. Cela est induit par la présence de l’écran, surface d’interaction interpersonnelle qui comporte ses limites en termes de transmission sensorielle, mais également par la divergence d’espace-temps entre les interlocuteurs. D’autres particularités de la rencontre virtuelle entrent alors en jeu.
Un langage verbal écrit
Si nous reprenons l’exemple de Sophie en relation avec Stranger36, nous observons qu’elle peut être très sensible à l’expression écrite. Par sa façon d’écrire, Stranger36 influence la représentation que se fait Sophie en rapport à son langage, voire sa voix, sa prosodie. Comme nous l’avons dit, le manque d’information entraine le recensement d’une sensorialité passée qui ferait écho à cette nouvelle expérience afin de la compléter. Ainsi, Sophie associera Stranger36 à toute autre image en lien avec sa façon de s’exprimer à l’écrit.
Viennent d’autres éléments notables dans l’échange verbal écrit. Il y a l’intérêt porté à l’orthographe, la syntaxe, et la ponctuation. On retrouve aussi l’apport d’émojis et de gift qui viennent agrémenter la conversation d’une touche d’expression émotionnelle. Le rythme dans le phrasé n’est pas le même que celui d’une rencontre « in real life », car il est suggéré par la ponctuation et les paragraphes. Les émotions ont la possibilité d’être transmises par l’intermédiaire des émojis même s’ils restent impersonnels. Ces émojis demeurent cependant impersonnels puisque l’écran permet de masquer toutes expressions personnelles — propre à chacun de par son vécu familial et individuel — et les variations toniques qui peuvent se discernent lors d’une rencontre directe.
Être présent à distance
Comme nous l’avons vu précédemment, les rencontres amoureuses virtuelles sont tout aussi bien dominées par la sensorialité qu’une rencontre lambda. Selon Michel Delage, chef de service de psychiatrie, ces stimulations sensorielles sont des rappels de la sensorialité de l’enfance sur laquelle s’établissent les premiers attachements. Le système d’attachement serait ainsi réactivé.
Défini par J. Bowlby, psychiatre et psychanalyste, l’attachement fait référence à un besoin de protection qui reste présent tout au long de la vie. Dès l’enfance, les situations de détresse vécues par l’être humain induisent une réaction de la « figure d’attachement », c’est-à-dire la personne de référence en cas de sentiment d’insécurité. Si ses réactions sont apaisantes, l’être humain se développe en intégrant une sécurité interne suffisante. Il peut alors se séparer de sa figure d’attachement sans crainte. L’attachement est dit « sécure » si la séparation est bien vécue. Il est dit « insécure » si la personne reste en difficulté. Elle peut se montrer alors fuyante, en recherche d’attention ou déboussolée). Lors d’une rencontre virtuelle, si les deux protagonistes sont sécures, les adaptations se feront pour l’un comme pour l’autre sur la base des échanges et des interprétations perceptibles via l’écran.
En effet, le développement de la relation se base sur la stabilité du système excitant/pare-excitant. Il s’agit d’un équilibre entre les situations déstabilisantes et la réponse rassurante du tiers. Ainsi cette évolution de la relation nécessite d’établir une capacité à être soi dans la relation. En effet, un rapport excitant/pare-excitant est mis en jeu en regard de la nouveauté de la situation et par la possible émergence de conflits intrapsychiques.
Une relation sous contrôle ?
Dans notre illustration, cette relation est fonctionnelle ce qui signifie que les interactions dans la relation sont suffisamment saines, rassurantes, et contenantes pour que les deux protagonistes se dévoilent sereinement. Sophie se sent entendue, car il y a une réponse de l’autre adaptée à sa propre émission. Elle se sent unique : les phrases et les photos qui lui sont adressées lui sont destinées, car elle est reconnue comme unique. Elle sait gérer la frustration d’un message qui n’a pas eu l’effet escompté (l’absence de l’autre), car elle est individualisée. L’ensemble permettant d’avoir une relation à soi et un ancrage suffisants pour supporter les variations dans la relation qui s’installe.
Une sécurité trompeuse ?
La rencontre nous replace face à notre propre identité. En effet, on parle de ce que nous aimons faire, de ce qui nous intéresse et que nous investissons ainsi que nos expériences. C’est un ensemble qui fait notre identité actuelle et qui se remanie perpétuellement de façon spectaculaire ou infime, qui est présenté à l’autre.
Il existe une sensation plus ou moins erronée de sécurité en ligne. Les protagonistes se sentent protégés par l’absence de regards, par la possibilité de fuite à tout moment. La notion de cadre contenant, soutenant et rassurant est totalement revisitée. La personne peut sembler en avoir moins le besoin. Elle n’est pas confrontée à la présence physique de l’autre, le détachement immédiat est donc possible. Néanmoins, si la sécurité physique est là, c’est psychiquement que l’impact du manque de contenance de l’autre peut avoir un effet. Par exemple, elle entrainera des ruminations culpabilisantes si le contact, tant virtuel qu’il soit, n’a pas été rassurant : « Je n’aurais pas dû dire cela », « Pourquoi n’a-t-il n’a pas répondu ? ».
Un engagement à géométrie variable
La notion de temps, de rythme et de durée est modifiée. Par la distance établie par écrans interposés, Sophie a le temps de penser sa façon de s’exprimer, cacher des réactions qu’elle ne voudrait pas exhiber et même mettre fin à une discussion en se déconnectant n’importe quand. L’engagement personnel peut être moins important, sans pour autant être manifeste.
D’UNE PROXIMITÉ PSYCHIQUE À UNE PROXIMITÉ PHYSIQUE
Lorsque la rencontre virtuelle devient concrète, les protagonistes enrichissent bien plus que les informations sensorielles perçues.
Une distance virtuelle supprimée
La notion de distance dans la rencontre réelle renvoie à la proxémie et aux travaux d’Edward Hall. Ce dernier a classé les distances pouvant exister entre deux personnes, dans un contexte occidental, qui communiquent en quatre sphères :
– la sphère intime dans un rayon de moins de 45 cm
– sphère personnelle dans un rayon de 45 à 120 cm
– la sphère sociale dans un rayon de 1,20 à 3,60 mètres
– sphère publique dans un rayon de plus de 3,60 mètres.
Lors d’un rendez-vous galant, la proximité attendue sera donc en dessous de 120 centimètres, et en dessous de 45 centimètres si tout se passe bien…
De la 2D à la 3D
Les tendances corporelles peuvent également être observées dans leur globalité dans les différents plans et niveau de l’espace : l’être convoité prend forme. La perception de l’autre dans un espace en volume devient possible et les représentations réalistes. Ainsi, les postures, les mouvements et gestes prennent une toute autre forme passant de la perception 2D à la 3D.
Avec la suppression des écrans, vient également la confrontation à ce qu’il se passe réellement pendant les silences. Ce qui jusqu’ici pouvaient être traduits par une attention distraite par des actions fictives. Ainsi, il faudra être capable de soutenir ces silences maintenant que leur sens n’est plus imaginaire.
POUR CONCLURE
Nous avons constaté que, lors d’une rencontre virtuelle, les manifestations psychocorporelles sont certes moins spontanées que lors d’une rencontre hasardeuse dans la vie de tous les jours. Elles restent cependant accessibles et d’une intensité propre à cette forme de rencontre. L’interaction avec l’autre est riche de captures sensorielles qui se font de façon séquentielle. Mais elles permettent au corps de tendre vers une perception générale qui se construit petit à petit. C’est peut-être ce qui en fait le succès des rencontres sur le web : pouvoir prendre le temps de ressentir petit à petit chaque nouvelle sensation induite et laisser s’exprimer librement les fantasmes en attendant la confrontation au réel. Nous notons que, dans une rencontre réelle, l’imaginaire reste présent, il est simplement soutenu de façon plus vive par du sensoriel.
La rencontre amoureuse en ligne ne serait qu’une autre manière d’amorcer une rencontre n’annulant pas la possibilité de vivre le sentiment amoureux ni les sensations associées. Les espaces virtuels sont des nouveaux lieux de rencontre, mais les modes de rencontres davantage sensoriels restent au goût du jour.
Pour aller plus loin (sources) :
ALBARET, J.M., SCIALOM, P., GIROMINI, F. (dir.). Manuel d’enseignement de psychomotricité : concepts fondamentaux (vol.1). Paris, France : DE Boeck-Solal.
BELOT Rose-Angélique, SANAHUJA Maria de la Almudena. « Obésité chez l’adolescente et défaillance dans la construction du pare-excitation à l’épreuve du Rorschach », Psychologie clinique et projective, vol. 20, no. 1, 2014, pp. 247-277.
COMBES Valérie. » Infraverbal pour communiquer avec l’enfant autiste », Paris, 2013 : https://cliniquedelenfant.wordpress.com/2013/01/18/soigner-lenfant-autiste-reconcilierles-approches/
DE MELO MARTINS KUYUMJIAN Marcia. « L’autoreprésentation dans la trajectoire des Garimpeiros », 1998.
DELAGE Michel, et al. « Application de la théorie de l’attachement à la compréhension et au traitement du couple. À propos d’une recherche », Thérapie Familiale, vol. 25, no. 2, 2004, pp. 171-190.
FLAVIGNY Christian. ‘Le virtuel : site pour l’inconscient ?’, Champ psychosomatique, vol. no 22, no. 2, 2001, pp. 111–131.
GRAVEL Caroline. « Relation virtuelle, amour virtuel : quelle place pour l’amour véritable ?, Québec, 2018
LARDELLIER Pascal, “À corps joie, à cœur perdu…”, Revue des sciences sociales, 58 | 2017, 46-53.
LEVY Pierre, “Sur les chemins du virtuel”. 2007. https://www.volubilis.org
TISSERON Serge, “Virtuel, mon amour : penser, aimer, souffrir, l’ère des nouvelles technologies”, Albin Michel, 2008.
VIAL Stéphane. “Critique du virtuel : en finir avec le dualisme numérique”. Psychologie Clinique, EDP sciences, 2014, Le virtuel pour quoi faire ? Regards croisés, pp.38-51VITALI-ROSATI Marcello, La virtualité d’Internet. 2009. Sens public. http://sens-public.org/articles/669/